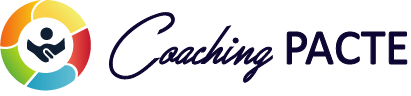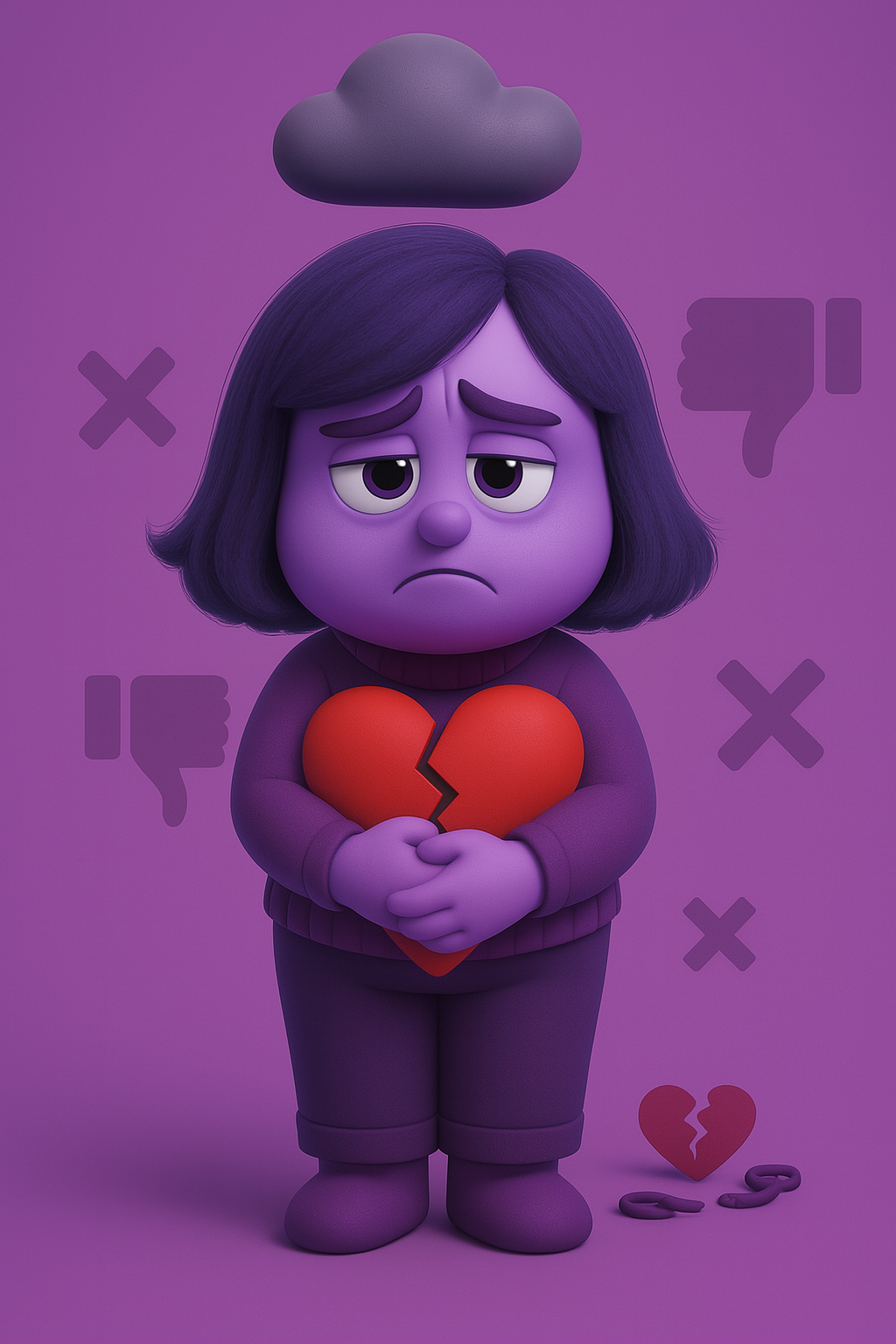
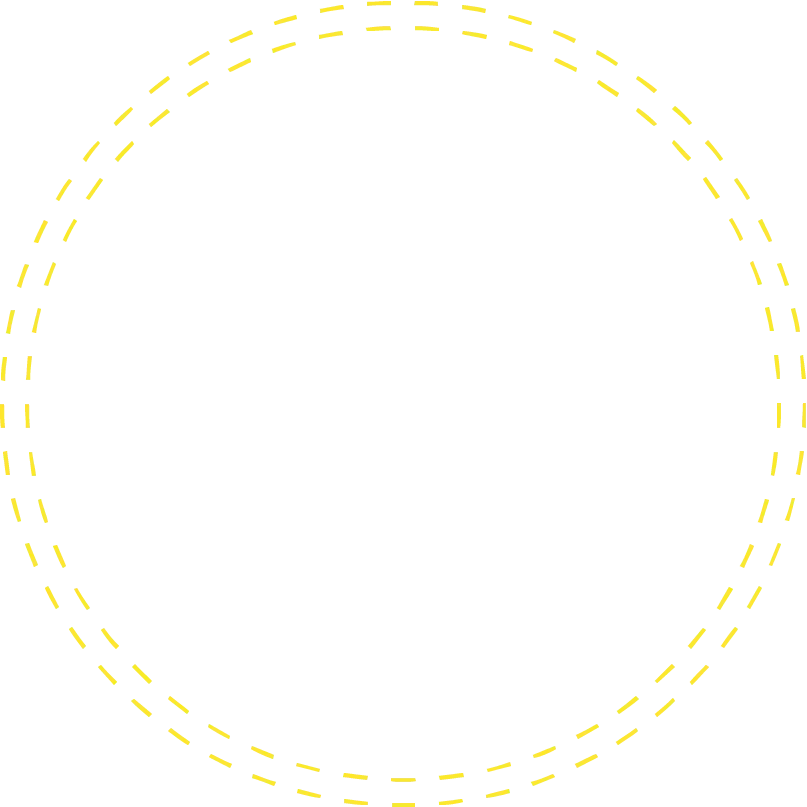
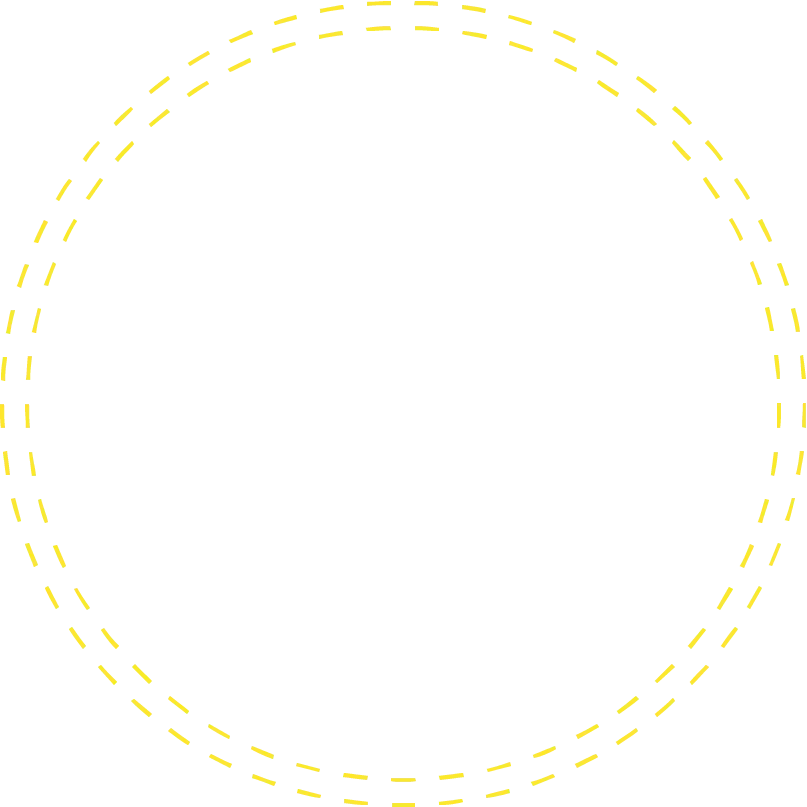
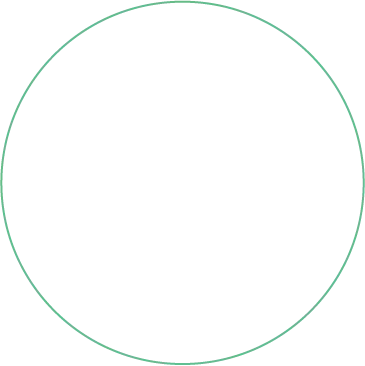
 Découvrir cette faille psycho-affective
Découvrir cette faille psycho-affective
Le rejet
La faille de rejet correspond à une peur viscérale d’être exclu ou de passer inaperçu. Pour se protéger, l’individu peut soit se montrer très critique, soit, au contraire, se rétracter et limiter toute interaction. Cette crainte colore son regard : chaque silence est perçu comme une mise à l’écart, chaque oubli comme un signe de désaveu. Il en résulte une vigilance permanente qui épuise la personne et perturbe son entourage. Dans un contexte professionnel, cette tension latente freine la prise de décision et l’expression d’idées nouvelles. Enfin, la faille de rejet n’est jamais figée : elle s’active surtout quand la personne doute de sa valeur ou de sa légitimité.


Forte tête
est la forme active de la faille du rejet.

Réservé introverti
est ma forme passive de la faille du rejet.
 Les origines de la faille du rejet
Les origines de la faille du rejet
L’origine première se trouve souvent dans des expériences passées où la personne a réellement ressenti de la mise à l’écart : moqueries scolaires, clans familiaux fermés ou précédents emplois très compétitifs. Un environnement professionnel où la reconnaissance est rare, les règles floues ou les promotions peu transparentes réactive facilement cette blessure. Les contextes de changement rapide – fusion, réorganisation, télétravail massif – amplifient la sensation d’être oublié au bord du chemin. La faille s’ancre aussi dans certains traits de personnalité : faible estime de soi, tendance perfectionniste ou introversion marquée. Parfois, un événement ponctuel suffit : un projet retiré sans explication ou un message resté sans réponse. Peu à peu, la personne interprète chaque détail comme la preuve d’un rejet imminent et développe des stratégies défensives (hyper-contrôle, ironie, retrait). Comprendre ces racines aide à distinguer la blessure ancienne du contexte présent et à éviter les jugements hâtifs.
 Les besoins sous-jacent de la faille du rejet
Les besoins sous-jacent de la faille du rejet
Le premier besoin est celui d’appartenance : sentir qu’on occupe une place claire et reconnue au sein du groupe. Vient ensuite la reconnaissance : un feedback factuel et régulier qui valide les compétences et les efforts. S’y ajoute une exigence forte de sécurité relationnelle ; un climat prévisible et respectueux réduit la vigilance excessive. Pour se rassurer, la personne recherche aussi des repères concrets : règles explicites, objectifs définis, canaux de communication fiables. Un autre besoin, moins visible, est le droit à l’autenticité : pouvoir partager ses doutes sans craindre d’être jugé. Enfin, la faille de rejet se résorbe quand l’individu expérimente une valorisation équilibrée : ses réussites sont saluées, ses erreurs corrigées sans sarcasme, et son identité est décorrélée de sa seule performance. Répondre à ces besoins transforme progressivement la peur d’exclusion en confiance partagée et libère l’énergie créative jusque-là mobilisée par la défense.
 Comment détecter la faille du rejet ?
Comment détecter la faille du rejet ?
Pour identifier la faille de rejet chez une personne, il est utile d’observer une constellation de signes plutôt que de s’arrêter à un seul indice.
D’abord, prêtez attention aux doutes sur ses compétences : si le collaborateur exprime régulièrement qu’il « n’est pas à la hauteur », cela révèle souvent une faible estime de soi alimentée par la crainte d’être exclu ou jugé.
Viennent ensuite les comportements d’évitement. Une personne qui refuse systématiquement de prendre la parole en réunion, qui décline les présentations ou se tient volontairement en retrait cherche, consciemment ou non, à se protéger du regard des autres pour prévenir un éventuel rejet.
Observez aussi ses réactions aux critiques. Lorsque la moindre remarque, même constructive, déclenche une défense disproportionnée (justifications, anxiété visible, retrait soudain), la blessure de rejet se manifeste clairement : la critique est vécue comme une confirmation d’exclusion plutôt que comme un simple feedback.
Le passé relationnel joue, lui aussi, un rôle clé. La présence d’anciennes remarques dévalorisantes — qu’elles proviennent de managers ou de collègues — crée un terreau propice à la peur du rejet ; ces expériences renforcent la conviction intime de ne jamais être « assez ».
Enfin, repérez la quête de validation. Un collaborateur qui se met constamment en avant, qui recherche les compliments ou qui souligne sans cesse ses réussites tente souvent de combler l’insécurité née de cette faille : être validé devient une manière de repousser la possibilité d’être mis à l’écart.
En synthèse, la faille de rejet se lit dans un cocktail de doutes persistants, de retrait stratégique, d’hypersensibilité aux remarques, d’historiques relationnels douloureux et de besoins répétés de reconnaissance. Croiser ces indices, plutôt que de les considérer isolément, permet de discerner avec justesse si cette blessure profonde influence le comportement professionnel.