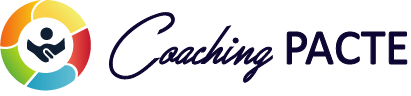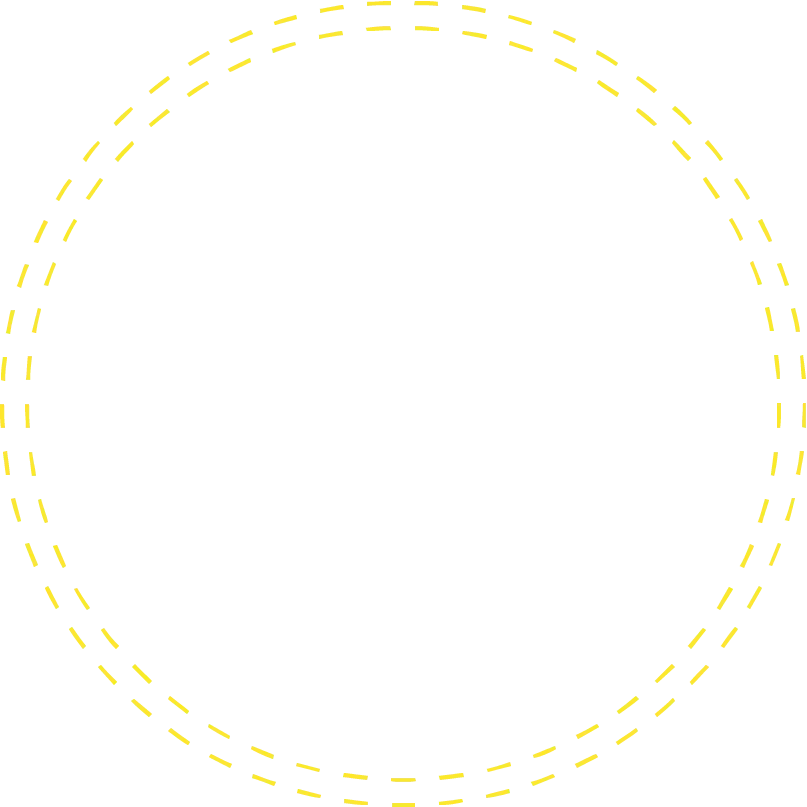
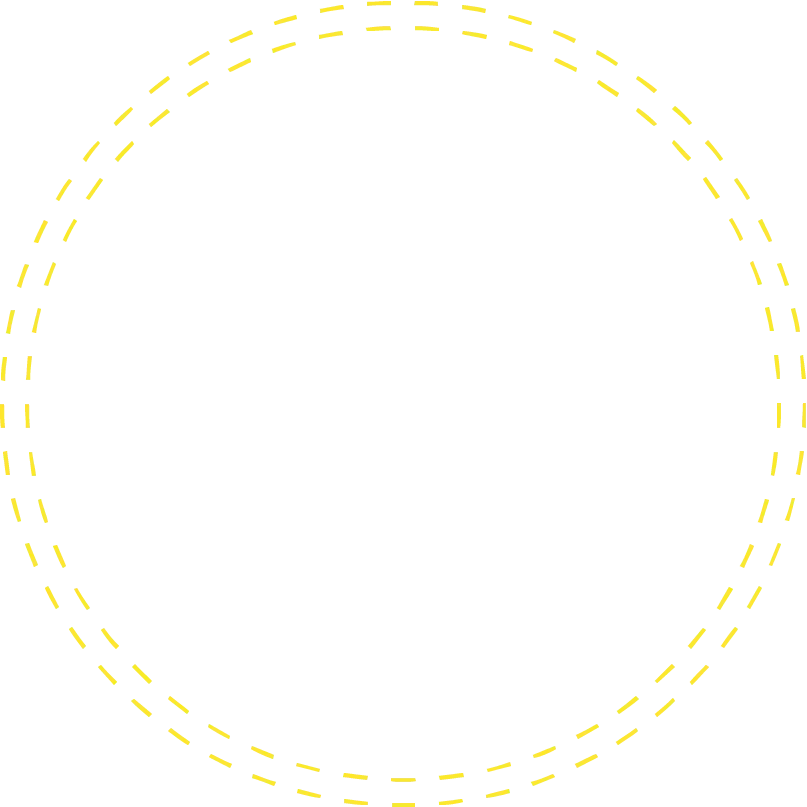
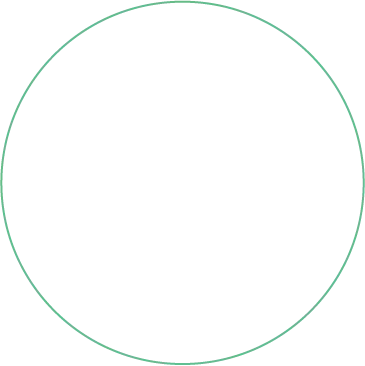
 Découvrir cette faille psycho-affective
Découvrir cette faille psycho-affective
La privation et le manque
La faille de privation/manque naît d’une impression chronique de ne jamais disposer des ressources suffisantes – qu’il s’agisse de temps, d’outils ou de soutien. Ce vide perçu pousse à accepter trop de tâches ou, à l’inverse, à différer l’action pour éviter l’échec annoncé. Chaque retard de livraisons ou allocation floue vient confirmer la conviction intime que « ce ne sera jamais assez ». Peu à peu, la personne bascule entre sur-engagement et apathie, oscillant entre vouloir tout compenser ou ne plus essayer. Cette dynamique entretient un stress latent qui grignote motivation et bien-être, tout en impactant la circulation des idées dans le groupe.


Procrastinateur
est la forme active de la faille de la privation et du manque.

Flemmard
est ma forme passive de la faille de la privation et du manque.
 Les origines de la faille de la privation et du manque
Les origines de la faille de la privation et du manque
La première source se situe souvent dans des expériences passées de carence matérielle ou affective : postes sous-dotés, familles où l’effort n’était jamais récompensé, scolarités sans accompagnement. Un environnement professionnel instable – budgets serrés, équipes réduites, objectifs mouvants – réactive la blessure et renforce la lecture « manque ». S’y ajoutent certains profils personnels : perfectionnisme, tendance à l’anxiété, besoin de contrôle pour combler l’incertitude. Quand les procédures sont opaques ou les priorités changent sans explication, l’individu anticipe déjà la pénurie suivante et redouble d’efforts… jusqu’à l’épuisement. Parfois, un seul événement suffit : un projet abandonné faute de moyens ou un soutien promis puis retiré. Ces accumulations forgent une mémoire de déficit ; chaque aléa rappelle la peur originelle et enclenche des stratégies de compensation coûteuses.
 Les besoins sous-jacent de la privation et du manque
Les besoins sous-jacent de la privation et du manque
Le besoin premier est l’accès à des ressources adéquates : outils disponibles, délais réalistes, informations fiables. Vient ensuite un soutien structuré ; des points réguliers et un feedback concret réduisent l’angoisse de manquer. La personne recherche aussi des opportunités de développement pour sentir que l’investissement présent ouvrira des portes, et non un nouveau vide. Une reconnaissance factuelle – « voilà ce que ta contribution a permis » – nourrit l’estime sans flatterie. Des repères explicites (priorités, critères de succès) l’aident à doser ses efforts et à dire non lorsque la charge déborde. Enfin, un climat de sécurité psychologique où l’on peut exprimer ses limites sans être taxé de « démotivé » assèche la peur de privation et libère l’énergie créative jusque-là captée par la compensation.
 Comment détecter la faille de la privation et du manque ?
Comment détecter la faille de la privation et du manque ?
Pour identifier la faille de rejet chez une personne, il est utile d’observer une constellation de signes plutôt que de s’arrêter à un seul indice.
D’abord, prêtez attention aux doutes sur ses compétences : si le collaborateur exprime régulièrement qu’il « n’est pas à la hauteur », cela révèle souvent une faible estime de soi alimentée par la crainte d’être exclu ou jugé.
Viennent ensuite les comportements d’évitement. Une personne qui refuse systématiquement de prendre la parole en réunion, qui décline les présentations ou se tient volontairement en retrait cherche, consciemment ou non, à se protéger du regard des autres pour prévenir un éventuel rejet.
Observez aussi ses réactions aux critiques. Lorsque la moindre remarque, même constructive, déclenche une défense disproportionnée (justifications, anxiété visible, retrait soudain), la blessure de rejet se manifeste clairement : la critique est vécue comme une confirmation d’exclusion plutôt que comme un simple feedback.
Le passé relationnel joue, lui aussi, un rôle clé. La présence d’anciennes remarques dévalorisantes — qu’elles proviennent de managers ou de collègues — crée un terreau propice à la peur du rejet ; ces expériences renforcent la conviction intime de ne jamais être « assez ».
Enfin, repérez la quête de validation. Un collaborateur qui se met constamment en avant, qui recherche les compliments ou qui souligne sans cesse ses réussites tente souvent de combler l’insécurité née de cette faille : être validé devient une manière de repousser la possibilité d’être mis à l’écart.
En synthèse, la faille de rejet se lit dans un cocktail de doutes persistants, de retrait stratégique, d’hypersensibilité aux remarques, d’historiques relationnels douloureux et de besoins répétés de reconnaissance. Croiser ces indices, plutôt que de les considérer isolément, permet de discerner avec justesse si cette blessure profonde influence le comportement professionnel.