

Une colère est-elle juste ?
Dans un open space un peu trop bruyant, un chef de projet explose. « C’est injuste, on change encore les priorités ! » On soupire, on s’offusque, on le range mentalement dans la case « colérique ». Mais a-t-on vraiment entendu ce que sa colère raconte ? Depuis Freud, on sait que nos gestes, nos choix et nos silences sont traversés par des forces qui nous dépassent. L’inconscient organise des défenses, détourne des colères, fabrique des certitudes. Les approches corps-esprit de Reich, Lowen et Pierrakos ont prolongé cette intuition : une émotion « négative » n’est pas contre la vie ; c’est un mouvement de vie qui, s’il est nié, se tord et finit par blesser. Dans cette grille, la colère n’est ni un péché capital ni une vertu automatique : c’est un signal. La question n’est donc pas « faut-il se mettre en colère ? », mais « de quoi cette colère est-elle le messager ? » et « comment la traverser sans détruire ? ».
La colère, réflexe vital… puis risque de déformation
Dans la théorie de l’énergie de Pierrakos, bloquer l’élan vital engendre des accumulations qui finissent par éclater : « la violence survient quand l’expression saine – dont la colère justifiée – est empêchée ». A contrario, quand on accueille et canalise ce qui s’élève, l’énergie retrouve sa direction : « plus nous acceptons notre haine, moins nous haïssons ». C’est toute l’ambivalence du phénomène : la colère est d’abord une défense de l’intégrité, puis elle se tord si elle est interdite ou survalorisée. On n’a pas affaire à un « vice », mais à un mouvement à orienter.
Cette lecture éclaire de nombreuses scènes de bureau. Dans une organisation qui compressent les délais et bousculent les repères, les cycles sainement humains d’assertivité et de réceptivité se dérèglent. Trop d’assertivité devient agressivité ; trop de réceptivité se fige en passivité. La colère surgit alors au mauvais endroit, au mauvais moment, et masque parfois une peur, une honte, une sensation d’impuissance.
Blessures et masques : ce que crie la colère
Les blessures décrites par Lise Bourbeau aident à décoder ces déformations. Injustice, rejet, trahison, abandon, humiliation : chez l’adulte comme chez l’enfant, ces atteintes précoces laissent des « faille » qui réapparaissent sous stress. Nous apprenons des masques pour ne plus souffrir ; mais ces masques – rigide, contrôlant, etc. – finissent par écraser le vivant et colorer nos réactions. Ainsi, quand la blessure d’injustice s’active, la personne rigidifie ses standards, s’enflamme pour l’équité et peut s’emporter… parfois au bon endroit, parfois contre elle-même ou la mauvaise cible. Là encore, le message n’est pas « colère interdite », mais « colère à relire ».
Dans La guérison des 5 blessures, Bourbeau rappelle que beaucoup nomment « rejet » ou « abandon » une douleur qui, en réalité, réveille injustice ou trahison ; c’est la réaction – pas l’étiquette – qui révèle la blessure activée. L’important, pour apaiser, est de reconnaître honnêtement ce qui est touché, chez soi et chez l’autre.
Quand la colère est juste
La colère est juste quand elle défend une valeur légitime, quand elle nomme un tort réel, quand elle restaure une frontière. Les traditions psychanalytiques et corporelles convergent : l’émotion dite « négative » est une information sur la violation d’un besoin. L’empêcher d’exister ne rend personne plus vertueux ; cela prépare seulement un retour plus violent, ou une corruption en sarcasme, rancœur, passif-agressif. Dans la perspective corps-énergie, voir une colère « éclore » librement face à l’oppression peut même être « beau » ; c’est lorsqu’on la bloque qu’elle s’empoisonne et se fait destructrice. Au travail, refuser systématiquement d’entendre l’indignation authentique d’une équipe ouvre la voie à la lassitude ironique, aux résistances souterraines et, parfois, à la fuite des talents.
La colère devient injuste lorsqu’elle n’est plus la voix d’un besoin présent mais la répétition d’une ancienne scène – quand le masque parle à la place de la personne. Une remarque anodine ravive l’injustice d’hier ; un arbitrage neutre réveille la trahison de jadis. Plutôt que d’argumenter sur les faits, chacun rejoue alors sa blessure. Identité meurtrie contre identité meurtrie. Là, la colère n’éclaire plus ; elle aveugle.
Traduire la colère en action utile : l’apport de PACTE
Dans Manager les 20 personnalités difficiles, la méthode PACTE propose un fil rouge opérationnel pour faire passer la colère d’un choc à une décision. Cinq verbes, cinq postures : Percevoir, Analyser, Communiquer, Transformer, Évaluer. L’idée est simple : on ne « gère » pas une émotion à coups de morale, on l’inscrit dans un processus qui l’accueille, la nomme, puis la convertit en choix observables.
Percevoir, c’est d’abord rétablir les faits : qu’a-t-on réellement dit, demandé, livré ? L’œil du manager s’interdit l’interprétation hâtive et distingue le comportement de la personne. Analyser consiste ensuite à identifier la faille psycho-affective en jeu et son mode d’expression : actif (confrontation, agressivité, contrôle) ou passif (évitement, plaintes). Communiquer, c’est ouvrir un espace où chacun parle depuis ses besoins – reconnaissance, sécurité, équité – plutôt que depuis son masque. Transformer, c’est co-décider de petits engagements concrets qui réparent le tissu du travail. Évaluer, enfin, permet d’ancrer le changement et d’éviter les rechutes mécaniques. Le cycle est itératif ; on peut revenir à « Percevoir » et « Analyser » si le terrain bouge.
Le cas du « colérique » : une boussole, pas une étiquette
Parmi les vingt profils décrits, le « E+ » – le colérique, blessure d’injustice en mode actif – est emblématique : il réagit intensément à ce qu’il juge inéquitable, conteste l’autorité s’il la perçoit arbitraire, cherche des solutions immédiates, parle fort et tranche net. À l’état brut, il peut abîmer la coopération ; bien cadré, il devient un formidable capteur d’incohérences. Son besoin central : le respect et la lisibilité des règles du jeu. Son risque majeur : confondre « ne pas être d’accord » et « être lésé ».
Que faire quand sa colère éclate en public ? Le livre recommande un arrêt verbal bref – « Je vois que tu trouves la situation injuste, on s’en parle à part tout de suite » –, puis un recentrage sur les faits et, enfin, une invitation à proposer une alternative. Reconnue et canalisée, l’énergie s’oriente vers la réparation ; ignorée ou humiliée, elle redouble.
Côté posture managériale, deux styles sont structurants : un cadre directif clair (règles, limites non négociables) et une communication explicative (le pourquoi des décisions). L’un rassure par la prévisibilité, l’autre apaise par l’intelligibilité ; l’ensemble réduit la tentation d’explosion. A contrario, un participatif « pur » ou un délégatif sans balises aggravent la perception d’arbitraire.
La colère vue par le corps : recontacter l’assise
Les approches bioénergétiques notent que l’agressivité déraille souvent quand l’assertivité n’est plus « posée ». On « monte » en force dans le torse et la tête, on « perd » les jambes : l’énergie n’est plus ancrée, elle cherche à contrôler l’extérieur faute de sentir le sol. Retrouver l’appui – respirer, marcher, s’asseoir avant de parler – n’est pas du folklore : c’est ce qui rend de nouveau possible l’alternance saine entre dire et écouter, agir et recevoir. Sans cet ancrage, la colère se fait posture et la relation devient duel.
Juste pour qui ? Juste comment ?
Revenons à notre chef de projet. Est-ce « juste » qu’il se mette en colère ? La réponse se joue en trois temps. D’abord le pour qui : pour lui, sa colère est un baromètre ; elle dit qu’une valeur – l’équité de traitement – est touchée. Pour l’équipe, elle peut être à la fois un signal utile (une incohérence pointée) et un stress inutile (forme inadaptée). Ensuite le sur quoi : la colère est pertinente si elle s’adresse au bon niveau – la règle, le processus, la décision –, pas à la personne. Enfin le comment : forme brève, factuelle, suivie d’une proposition. Ce triptyque évite deux impasses : la culpabilisation (« je n’ai pas le droit d’être en colère ») et la décharge (« j’ai le droit d’exploser »). Entre les deux, une boussole : transformer une émotion en exigence de clarté.
Dans le concret, PACTE offre des garde-fous : d’abord percevoir l’événement sans narratif (« la priorisation a changé hier à 16h »), puis analyser la faille activée (injustice probable), communiquer en séparant personne et acte (« je me sens lésé car le périmètre a bougé sans concertation ; de ton côté, que vois-tu ? »), transformer en décidant d’une règle (toute bascule de priorité se fait sur un canal unique, avant telle heure), évaluer quinze jours plus tard (la règle tient-elle ?). Ce protocole n’endort pas la colère ; il lui donne une issue.
À quoi reconnaît-on une colère devenue force ?
Quand elle sert la précision – pas l’humiliation. Quand elle ouvre des alternatives – pas des camps. Quand elle accepte d’être mesurée – par un fait, un délai, un critère. Et quand, si l’on s’est trompé d’adresse, elle sait se reprendre, voire s’excuser. Les cliniciens du corps et de l’énergie le répètent : une émotion pleinement vécue perd sa charge toxique. « Plus nous acceptons la douleur, moins nous la ressentons », écrivait Pierrakos ; non pas parce qu’elle disparaît, mais parce qu’elle cesse de gouverner.
Pour le manager, l’enjeu n’est pas de produire des collaborateurs « calmes », mais des équipes capables de traverser ensemble les activations de blessures : repérer, nommer, contenir, transformer. On n’éteint pas un feu en discutant de sa moralité ; on le ramène dans son foyer, qui s’appelle ici le travail bien fait, la règle claire, la parole tenue.
Verdict
Une colère peut être juste, à double condition. Elle l’est par sa cause – la défense d’une valeur vraiment heurtée –, et par sa forme – brève, adressée, constructive. Toute autre colère n’est pas « fausse » ; elle est probablement la voix d’une blessure qui demande autre chose que le bras de fer : parfois de la reconnaissance, parfois de la sécurité, souvent de la clarté. C’est là que votre pratique de Manager les 20 personnalités difficiles et la méthode PACTE deviennent décisives : non pour moraliser les affects, mais pour les organiser au service de l’action juste.
En somme, la colère n’a pas à être excusée ni interdite. Elle doit être entendue, traduite, bornée. À cette condition, elle cesse d’être un projectile et redevient ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une boussole.
David Eyraud, coach professionnel, spécialisé dans l’accompagnement des managers et auteur du livre « Manager les 20 personnalités difficiles » aux éditions GERESO.
Me joindre : 07.61.51.63.26 / david.eyraud@coaching-pacte.com
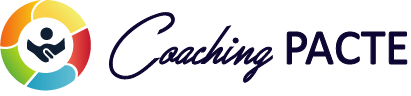

 Test de 10 minutes gratuit
Test de 10 minutes gratuit 